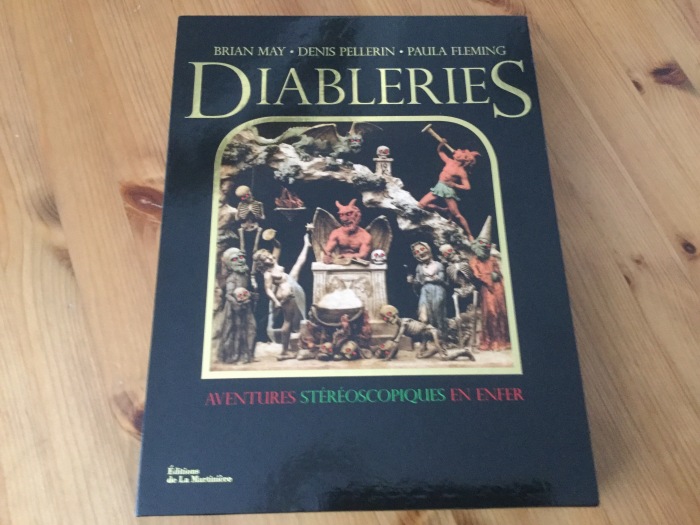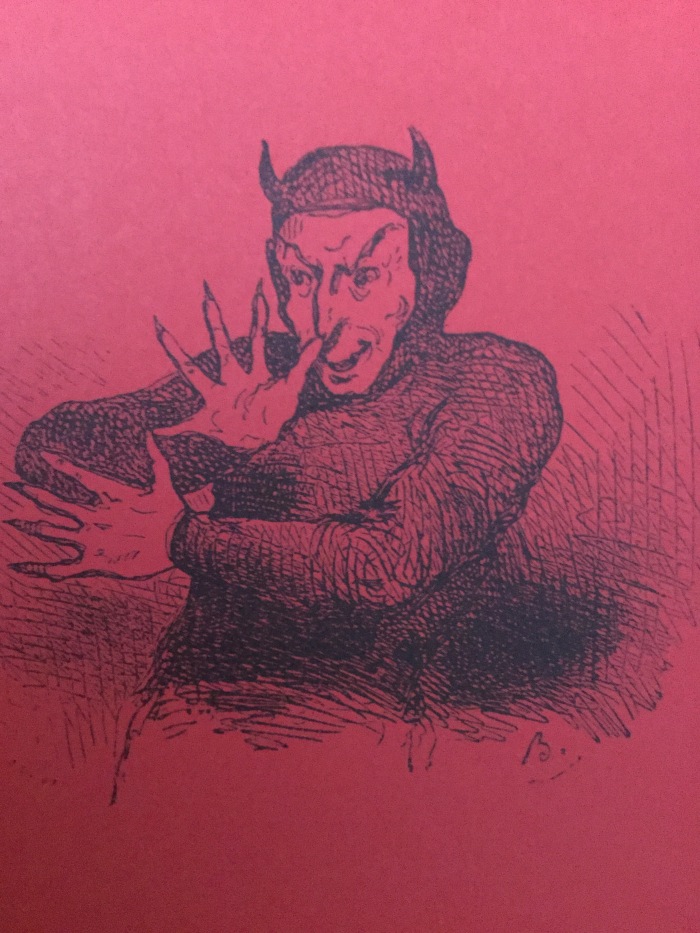Dire de Love Exposure qu’il tient du miracle tient autant de l’euphémisme que du jeu de mot volontaire, eu égard au thème et à la durée du film.

Soit un jeune héros, Yu (Takahiro Nishijima), un cœur pur, fils d’un homme devenu prêtre suite au décès de sa femme (Asturo Watabe),endeuillé tout jeune par le décès de sa mère qui l’encourage à chercher sa « Marie ». Dès lors débute pour notre héros la quête d’une vie.
Yu constate un changement de comportement d’un père plus vraiment avenant, voir froid. Constamment sur le dos de Yu pour savoir quel péché il aurait pu commettre au dehors, et la pureté de Yu étant ce qu’elle est, la discussion tourne court. En réaction, Yu intègre un gang de pervers complètement déjanté.
Le gang lui enseigne les rudiments du bon petit pervers. Il faut voir son agilité à prendre quelques clichés sous les jupes des filles avec une virtuosité inouïe et d’improbables acrobaties au service de son nouveau hobby. Autant de photo shoots à l’arrache comme autant d’hilarant morceaux de bravoure. Ça aurait pu être au mieux gentiment coquin ou au pire glauque… mais il n’en est rien. C’est juste très très drôle.
Un jour, après avoir perdu un pari, Yu doit se grimer en femme, parader dans la rue de la sorte, et embrasser une fille au hasard. Il revêt les habits de la Femme Scorpion.

Interlude.
Mais qui est la Femme Scorpion?
Héroïne nipponne d’une série de film sortie dans les années 70 et campée par Meiko Kaji à l’ecran. Trahie et bafouée par son amant, Matsu est envoyée en prison et cherche vengeance… votre humble serviteur ne l’a pas encore vu mais ce pitch bien plaisant donne envie de voir ça. Voilà voilà!
Fin de l’interlude.

Dehors, il assiste avec sa bande à l’agression d’une jeune fille (préméditée, l’agression, l’on découvrira plus tard). La fille, Yoko (Hikari Mitsushima) est dotée d’un très fort tempérament, et n’est pas non plus novice en bottage de cul visiblement. S’ensuit un combat de rue jouissif où Yu et Yoko bastonne à l’unisson. Sorti vainqueur du combat de rue, et nos deux héros toujours debout, Yu profite de l’occasion pour en finir avec son pari et embrasse Yoko. Cette dernière tombe sous le charme… de la Femme Scorpion!
Le titre du film apparaît enfin au bout de 58 minutes de métrage. Ah oui, au fait, le film dure 3h57. Le préambule est long mais à aucun moment laborieux, et on oscille constamment entre le drame et la comédie. Et les trois heures suivantes seront exactement sur ce fil ténu et fragile du mélange des genres. Le pari est réussi. Ça fonctionne à merveille!
Bref, si vous avez tenu au bout de ces 58 minutes sans avoir eu un bâillement poli, vous êtes bon pour une inoubliable expérience de cinéma.

Là est le miracle. On ne voit pas passer ces presque quatre heures de métrage. Et au final, on a du mal à étiqueter Love Exposure. Comédie? Drame? Thriller? Un peu des trois pour ainsi dire. Il est fortement question au milieu du film d’une secte, l’Eglise Zéro, qui s’immisce dans la vie de Yu et Yoko, à travers le personnage de Koike (Sakura Andô) , à la fois amoureuse (vraiment?) de Yu et voulant détruire Yoko, sa rivale principale, spirituellement s’entend.
On peut s’accorder cependant sur un point crucial : on a là à faire à une histoire d’amour vraiment atypique. Beaucoup de larmes et de sang vont couler pour sauver Yoko des griffes de l’Eglise Zéro. Une confrontation entre Yu et Yoko est à ce titre évocatrice (et accessoirement l’une des plus belles scène du film). Yoko remet en cause la perversion et le manque de foi en Dieu de son prétendant. Elle lui récite l’épître aux corinthiens alors que la bande son joue le concerto n°7 de Beethoven. De cette longue et intense joute verbale découlera un statu-quo total, chacun campant sur ses positions. La scène dure, dure et dure mais le jeu habité des deux jeunes acteurs est tel qu’elle est magnifique. Et dire que Sono Sion doutait de sa jeune actrice en début de tournage… voir sur l’écran sa longue tirade montre à quel point le réalisateur était un peu à côté de la plaque.
Qui eut cru qu’avec un tel sujet et surtout une telle durée de métrage Sono Sion ait pu accoucher d’un vrai chef-d’œuvre aussi irrévérencieux que touchant. (Cette fin… mais cette fin!).
Si toi aussi, chère lectrice, cher lecteur, tu as vu, aimé, voir détesté Love Exposure, n’hésite pas à donner ton avis!